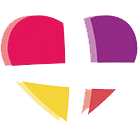Marie-Jo THIEL
Docteur en médecine et en théologie,
Directrice du Centre Européen d’enseignement et de recherche en éthique
Maître de conférences
Toute théologie parle de l’être humain autant que de Dieu. « Le divin, rappelle Jürgen Moltmann, est la situation dans laquelle l’homme s’éprouve, se développe et se forme. Théologie et anthropologie sont en relation réciproque. »[1] Autant dire qu’une théologie où celui qui est confessé Fils de Dieu meurt sur la croix, une théologie du « Dieu crucifié » selon l’auteur allemand, conduit à une anthropologie, et partant à des considérations éthiques en particulier sur la fin de vie, la manière de mourir et d’accompagner les mourants ; réciproquement, il faut reconnaître aussi que la manière d’envisager l’être humain influence la compréhension de Dieu. Et c’est sur les seuils et les frontières que s’évaluent et se vérifient la valeur des discours théologiques et anthropologiques et leurs rapports réciproques. La fin de vie est ainsi un lieu par excellence, un lieu difficile et mystérieux, qui n’a cessé au cours des âges d’alimenter des réflexions de tous ordres, plus ou moins élaborées, jusqu’à des ars moriendi, des « arts du mourir ».
Fondé sur la Bonne Nouvelle inouïe de la résurrection du Fils de Dieu Père dans l’Esprit, le christianisme a d’emblée intégré une parole sur la vie et la mort des croyants, et s’est montré particulièrement productif : « S’il n’y a pas de résurrection des morts, Christ, Christ non plus n’est pas ressuscité, notre prédication est vide est vide aussi notre foi » (1Co 15, 13-14). Car, écrit encore l’apôtre Paul, « si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité des mort, Christ ne meurt plus ; la mort sur lui n’a plus d’empire » (Rm 6, 8-9).
L’annonce est fabuleuse, mais que signifie-t-elle concrètement quand l’être humain souffre et meurt ? Le cœur passionné de la foi chrétienne est-il directement saisissable, ou demeure-t-il à jamais à distance, invitant à un travail herméneutique toujours à recommencer, au service d’une foi qui ne s’impose pas mais se propose et au service d’une humanité qui se regarde différemment selon les temps et les cultures ? Une distance ni infinie ni nulle, qui est celle qui nous sépare autant qu’elle nous relie à Christ mort et ressuscité, pour ouvrir la voie à une relation authentique qui ne verse pas dans la confusion. Grâce et au prix de cette distance, les récits fondateurs éclairent les vécus humains et, réciproquement, le souffrir et mourir de l’être humain permettent de comprendre de manière renouvelée les textes fondateurs.
En focalisant notre réflexion sur la souffrance en/de fin de vie, nous nous situons de surcroît en un lieu particulièrement stratégique où l’on mesure combien l’évolution de la médecine moderne rejaillit sur la compréhension de l’homme et de Dieu, et combien celle-ci, marquée par les développements biotechnologiques des dernières décennies mais aussi par l’événement de la Shoah, trouve là une instance critique pour des théories plus anciennes, dont certaines restent prégnantes aujourd’hui.
Le titre de cette contribution est à lui seul éloquent ! Y a-t-il une théologie de la souffrance face à la fin de vie ? Sans doute n’aurais-je pas personnellement osé une telle question, mais c’est un théologien protestant qui l’a mise au programme… Et elle ne manque ni d’impertinence ni d’ambiguïté sans doute volontaire ! L’expression « théologie de la souffrance » ne pointe-t-elle pas encore et toujours vers une interprétation doloriste de la passion du Christ, vers des théodicées et justifications diverses du mal, de la mort, de la souffrance ? Question redoutables et redondantes à travers les siècles, car si le mal ne vient pas de Dieu, il vient donc d’ailleurs, mais d’où ? Est-ce plus consolant ? Dieu laisse-t-il faire quand des humains souffrent ? Faut-il que
Dieu soit impassible, immuable, selon la perspective de l’Antiquité grecque, pour assurer à l’être humain de participer un jour à sa vie éternelle, dans la même impassibilité ? Ou le Dieu de Jésus Christ se manifeste-t-il d’abord comme com-patissant, révélant un pâtir-divin-avec l’humain souffrant et mourant ? Et quand, parmi d’autres, les éthiques du care mettent l’accent sur une juste appréhension de la vulnérabilité comme porosité existentielle et que le théologien[2] relie celle-ci à et en Dieu lui-même, qu’est-ce à dire ? Comment la théologie se saisit-elle de cette compréhension de l’être humain dans le discours de raison qu’elle professe sur Dieu ?
Le titre de cette contribution pose donc bien des défis à la théologie quand elle réfléchit à l’être humain confronté à la souffrance et à la mort, et à l’apport qui devrait être celui du christianisme. J’approfondirai trois points en me situant avant tout en théologienne. Je reviendrai d’abord sur les mots du titre pour montrer combien l’ambiguïté du vocabulaire nourrit déjà des réflexions diverses, antagonistes, rejoignant des présupposés anthropologiques non élucidés ; Dans une deuxième partie, je ferai l’hypothèse que le discours théologique autour de la souffrance et de la mort a été récemment infléchi de façon majeure d’abord par la réflexion initiée par la Shoah et ensuite par celle nourrie par la médecine biotechnologique moderne, sans entrer cependant dans les détails. Enfin j’évoquerai quelques points cruciaux de l’accompagnement chrétien en fin de vie.
- Souffrance de fin de vie et théologie
Souffre-t-on en fin de vie ? La question titrant cette contribution l’insinue, rejoignant bien des préjugés communs manifestes dans les sondages d’opinion où la mort peut être souhaitée par « peur de la souffrance ». Le débat actuel autour de la fin de vie le rappelle assurément. Quant au plan théologique, l’idée de parler de « théologie de la souffrance » ne suggère-t-elle pas également que cette souffrance serait grâce, moyen pédagogique ou de purification, envoyé par Dieu ? Les trois termes de ce titre – souffrance, fin de vie et théologie – s’articulent-ils nécessairement ?
La souffrance en fin de vie ?
Quand la vie approche de son terme, est-ce douloureux ? Est-on confronté à une souffrance spécifique ? Parfois, la mort est attendue et le mourant n’a mal nulle part (l’éventuelle douleur est traitée ou inexistante) ; tout au plus manifeste-t-il de l’impatience ou une inquiétude existentielle qui, à la proche de la fin de vie, peut parfois s’aiguiser. Si souffrance il y a, elle peut être physique – et dans ce cas, se pose la question médicale des antalgiques – ou encore psychologique et/ou spirituelle, car toute mort, même dans la foi, garde un caractère vertigineux qui peut se traduire par une souffrance que je qualifierai alors de « destinale » dans la mesure où elle engage le sens final de l’existence. Elle peut se traduire par un sentiment de disproportion entre la faiblesse la plus grande en son corps et cette responsabilité ultime devant « ma » mort à vivre ou, pour certains, à refuser (euthanasie) ; elle peut se traduire par de l’angoisse à laquelle on répond par le déni, la fuite, la dépression, le marchandage[3]… Ce peut être aussi une certaine fébrilité devant le devoir d’apposer la dernière brique à son existence et de lui donner son sens ultime ; voire de se réconcilier avec quelqu’un, et pour le croyant de se « savoir en état » (ou non) de rencontrer Dieu… Celui/celle qui est sur le départ peut alors vivre une expérience paradoxale : sentiment d’être vivant alors que la vitalité extérieure de la vie le quitte et le recourbe sur une grandissante fragilité, sérénité en dépit de la blessure mortelle de la vulnérabilité.
La souffrance est aujourd’hui mieux maîtrisée sur le plan médical. Mais il demeure souvent cette inquiétude informe, sentiment douloureux voire angoisse, car il faut quitter les siens, séparer du connu pour un inconnu (voire le néant). Temps d’entre-deux étrange, non forcément sans fécondité, surtout quand la parole reste possible, où l’esprit convoque des personnes ayant compté dans sa vie, des auteurs ayant imprégné sa pensée personnelle, des paroles méditées à telles ou telles occasion, versets bibliques ou sentences de sagesses, des échanges avec d’autres… Toutes choses susceptibles de nourrir la pensée qui vagabonde et d’offrir à qui se tient là des graines de vie pour une vie continuée. La douleur peut devenir souffrance tandis que la souffrance, à force de durer, peut s’évanouir en cet ultime sentiment de faiblesse qui n’en reste pas moins habitée par la vie intérieure, étape de croissance à l’orée de la mort vertigineuse qui consacre une vie, un rôle familial et social, une foi, une confiance, une amitié.
L’accompagnement de fin de vie tente d’y répondre, conscient que chacun vit ses derniers moments de manière unique et singulière. Mourir, c’est pour chacun la première et la seule fois. Et la mort est le lieu par excellence du non-savoir. Il ne faut donc jamais aller trop vite en besogne, pas même sur le plan de la foi. Comme l’a souligné Adolphe Gesché, « le risque est grand d’instrumentaliser Dieu, d’en faire une utilité, de le mettre au service du sens, voire à sa remorque. Affirmer sans plus que Dieu est le sens du sens, c’est faire fi de la consistance du sens. »[4] A force de relier la souffrance au péché, la tradition chrétienne n’a bien souvent considéré la fin de vie que comme le moment de la conversion ultime, du salut que m’on pourrait (et qu’il faudrait) quasiment imposer au mourant comme LE sens susceptible de favoriser une fin sereine, voire de rassurer (aussi) l’entourage. Le salut est certes important, a fortiori quand on est en fin de vie, mais la perspective chrétienne ne se résume pas à la sotériologie.
Une « théologie de la souffrance » ?
L’expression est pour le moins ambiguë. Le génitif « de » peut être compris de deux manières qui ne se valent pas mais peuvent s’interpénétrer en partie : théologie « de » peut signifier qui s’origine dans la souffrance, à l’instar des « théologies de la croix » s’appuyant sur la Croix du Christ ; il peut aussi indiquer une théologie qui répond à la souffrance. Dans la première acceptation, l’on accorde un primat (et éventuellement une valeur) à la souffrance ; dans la seconde, c’est la théologie qui est la première, éventuellement pour contrer la souffrance ou une certaine souffrance, mais la perspective est plus vaste que la seule souffrance. L’on est donc devant deux perspectives qui peuvent être diamétralement opposées, où la première reste peut-être aujourd’hui encore la plus prégnante, malgré les critiques dont elle fait l’objet.
Dans cette théologie découlant de la souffrance, on met l’accent d’abord sur la souffrance, la finitude et la mort que la créature humaine doit accueillir et faire siennes afin de communier aux souffrances du Christ et de puiser à la source de son salut. Dorothee Sölle en rappelle les idées-forces qu’elle tire de son travail d’enquête sur « la souffrance et la maladie vues à travers la littérature religieuse d’édification » :
La souffrance vient de la main de Dieu. Entre le péché et la maladie, il y a un lien trop souvent méconnu. Le péché est la racine la plus profonde, la plus authentique, de la maladie. Le malade méconnaît cette cause essentielle de sa maladie et attribue sa souffrance à des « circonstances extérieure », à des « causes naturelles ». Une pleine santé n’existera que dans le Royaume à venir. La maladie offre une occasion formidable de grandir et de mûrir intérieurement. Ne sentez-vous pas, justement quand vous êtes malade, comme Dieu est à l’œuvre en vous ? La grâce de la souffrance est plus précieuse que la guérison corporelle. La souffrance est un moyen pédagogique employé par Dieu d’Amour pour nous sauver…[5]
Et l’article « Souffrance » du Petit dictionnaire de théologie catholique de Karl Rahner et Herbert Vorgrimler[6], tout comme plus tard le Catéchisme de l’Église catholique, ne dit pas autre chose, au risque de tomber dans le masochisme ou encore l’apathie. Comme cette souffrance est envoyée par Dieu Créateur et Maître du monde, il devient inutile d’en chercher une autre cause, en particulier des causes sociales, et donc de lutter, de se rebeller… On pense à l’Amérique latine chrétienne d’avant la théologie de la libération, à l’Allemagne du 3e Reich qui a vu maints chrétiens se rallier au nazisme, etc., mais aussi à l’aumônier qui a appris sa théologie et explique à qui se meurt qu’il faut accepter la souffrance et la mort pour en faire des « causes » de salut. La fin de vie ne change rien à la perspective, mais accentue l’urgence et aussi la pression, car il faut paraître aussi « juste » que possible devant Dieu-Juge.
Quand il s’agit de la théologie qui répond à la souffrance, l’englobant-sujet est la théologie et la réponse peut être de dénoncer la souffrance, ou de moins de proposer un discours et une attitude qui permettent à tous (croyant y compris mais pas seulement) de donner sens à une existence marquée inévitablement par l’expérience de souffrance, sans se résumer à elle. La réponse engage comme précédemment des conceptions de l’hommes et de Dieu, elle peut prendre – comme dans la première acceptation, mais de manière différente – la forme d’une théodicée, c’est-à-dire, selon Leibniz, auteur de cette notion, d’un discours théologique justifiant la bonté de Dieu en dépit du mal et, plus encore, contrant le mal qui existe dans le monde. Jean-Baptiste Metz prône une théodicée comme discours engageant « le débat sur la bonté de Dieu » sans partager l’optimisme leibnizien[7].
Finalement, pouvons-nous envisager « une théologie de la souffrance face à la fin de vie » ? La réponse dépend du sens que l’on donne à ces mots certes simples mais qui, articulés, deviennent une dangereuse « pente glissante » (slippery slope) laissant deviner tous les écarts possibles quand le discours théologique traite de sujets aussi sensibles que la souffrance et la mort, le mal et la culpabilité, le pouvoir de, avec, pour et sur Dieu, etc.
- Discours théologique de fin de vie
L’Évangile[8] n’a pas eu peur de mettre en scène la fragilité humaine de Jésus ni même ses émotions (sa colère face aux vendeurs du Temple ou ses larmes à la mort de son ami Lazare par exemple). Il n’a pas sacralisé la souffrance de Jésus quand il fut menacé, arrêté, crucifié.
La théologie revisite sa vie et sa mort pour nourrir l’intelligence et la foi des croyants. Mais n’a-t-elle pas, parfois, trop parlé « sur » la souffrance, tentant « d’expliquer » et de tirer des conséquences de l’insondable mystère de la Croix, sans suffisamment de considération pour celui qui la vit en son corps, en son existence personnelle et relationnelle ? Au nom du salut et pour pousser le croyant y adhérer pleinement, elle a parfois idéalisé l’heure de la mort, en en faisant un temps presque facile, un ars moriendi où « il suffit » au disciple considéré comme un individu volontariste et docile de suivre, de s’unir, d’adhérer au Christ de la passion pour partager ensuite la béatitude impassible de Dieu. Le « oui » de l’heure de la mort étant assimilable au « oui » des ouvriers de la onzième heure de la parabole (Mt 20, 1-16), l’effort suprême d’union à la croix du Fils comprise comme souffrir et mourir avec et en Christ, jusqu’à refuser des antalgiques, vaut alors un mérite infini susceptible de racheter toute existence, et d’une certaine façon, de forcer Dieu à la grâce du salut…
L’imprégnation populaire de cette croyance reste d’ailleurs d’autant plus forte qu’elle est nourrie doublement :
- théoriquement par la théologie dite « de la satisfaction »[9] (Anselme de Cantorbéry) que L’imitation de Jésus-Christ rend familière (dolorisme), une certaine surdétermination sotériologique de la christologie et la déconnexion[10] d’avec la résurrection du Christ ;
- et pratiquement par cette considération anthropologique qui veut que l’individu confronté subitement à un mal (pensons par exemple à une annonce d’un cancer grave) cherche (au moins passagèrement) un « coupable » et/ou une figure tutélaire « capable » de remédier à la souffrance présente.
Ces deux perspectives qui se potentialisent confèrent ainsi au souffrant un rôle actif susceptible de contrer la passivité douloureuse et reprendre la main. Souvent la figure tutélaire est un dieu à l’image de l’homme auquel on offre des présents et des sacrifices, et qui n’a plus grande chose à voir avec le Dieu de Jésus-Christ. Avec la sécularisation et l’imprégnation sociale par les mouvements de médicalisation[11], c’est le faire technologique qui revêt cette figure tutélaire en laquelle il faut croire pour être sauvé[12]. Et elle demeure aujourd’hui plus forte que jamais, jusqu’à englober la mort qui doit rester pour ainsi dire « médicalisée », sous contrôle, mais qu’en même temps l’on promet aussi de vaincre un jour.
La théologie chrétienne prend peu à peu conscience de l’impact de sa dogmatique sur les considérations éthiques et anthropologiques qui en résultent. Mais il en faut plus pour infléchir le discours théologique autour de la souffrance et de la mort : ce sera surtout la réflexion initiée par la Shoah, et ensuite celle nourrie par la médecine technologique moderne.
La théologie de la croix, trop déconnectée de la foi en la résurrection, a montré ses insuffisances et ses défauts eu égard en particulier au drame d’Auschwitz qu’elle n’a pu ni éviter ni limiter, et par rapport auquel elle n’avait pas grand-chose, sinon rien à dire.
En même temps, l’évolution technique et l’emprise croissante de la médecine sur l’ensemble de la vie humaine modifient radicalement la manière qu’a notre contemporain de se comprendre. De plus en plus de pays autorisent l’avortement et l’euthanasie, par exemple, tout en promouvant les soins palliatifs. Des recherches autant que des mouvements philosophiques promettent la mort à la mort et déjà la fin du vieillissement. Tout cela suscite un déplacement anthropologique majeur qui interpelle le Magistère depuis plus de cinquante ans, mais semble diversement pris en compte[13] par lui, au point de creuser un sillon profond entre l’Église et le monde moderne…
Ces deux conjonctures inédites au regard de l’histoire portent au grand jour de graves lacunes des discours théologiques classiques quand ils valorisent trop universellement la souffrance, et obligent le théologien à repenser son discours. Cependant, peu de théologiens ont jusqu’ici pensé la souffrance et la fin de vie eu égard aux développements de la médecine contemporaine. Le magistère catholique tout comme les instances protestantes ont formulé des prises de positions éthiques, et c’est leur rôle, mais ce n’est pas encore là une vraie réflexion capable de nouer symboliquement les données théologiques pour que le sujet souffrant puisse s’y assumer et faire retour sur le fonds théologique. Les penseurs de l’après-Auschwitz ayant pris un peu « d’avance », ne pourraient-ils – c’est une hypothèse que j’aime faire – contribuer à renouveler la théologie de manière à mieux assumer le mystère de la souffrance et de la mort jusque dans leur dimension d’absurdité ?
Jürgen Moltmann, Hans Jonas, Jean-Baptiste Metz, et bien d’autres reconnaissent que leur situation personnelle « d’après Auschwitz » a définitivement et profondément impacté leur théologie, en les interrogeant d’abord sur le pourquoi on est arrivé là, sur la place et le rôle qu’a joué la religion dans l’Allemagne profondément imprégnée de christianisme et ensuite sur les conséquences théologiques de cet événement, la compréhension de Dieu, de l’humain, le rôle du croire, la place des Églises divisées, etc. Ils posent d’emblée la question de savoir si l’on peut opportunément parler de ce que l’on n’a pas vécu ou du moins si l’on peut seulement « discourir sur », sans cette expérience pour part personnelle et pour part partagée avec autrui. N’est-ce pas le caractère abstrait, c’est-à-dire délié du vécu concret, qui a conduit certaines théologies à l’instrumentation de la souffrance et à la vanité de leur propos au langage déconnecté des situations (extrêmes) auxquelles il a fallu essayer de faire face ?
- L’accompagnement chrétien de fin de vie et ses points cruciaux
L’accompagnement chrétien de fin de vie est un magnifique lieu d’observation et d’évaluation pour les discours théologiques visant la fin de vie, pour des personnes en souffrance, tout comme pour les accompagnants invités à les assumer.
Les pastorales d’accompagnement de fin de vie
La personnalité de l’accompagnant joue un rôle non négligeable, de même que son expérience, sa formation ou non. Si l’accompagnant est aguerri, il aura fait une « synthèse personnelle », une expression souvent entendue et qui signifie que, dans les discours officiels, on en prend et on en laisse et on adapte ce qu’on croit à la situation… Les plus jeunes, inexpérimentés, peuvent se sentir écartelés : déchirés entre d’une part une perspective de foi qui sur certains aspects leur semble d’une immense fécondité, et sur d’autres, totalement inappropriée, voire inhumaine ; et d’autre part des perspectives médicales qui paraissent incontournables tout en interrogeant elles aussi sur le comment ne pas aller « trop loin » …
La personnalité de chacun, sa manière de comprendre l’héritage chrétien suscite des attitudes et des discours divers que l’on peut ramasser selon trois modalités schématiques :
- ceux qui se comportent et agissent comme s’ils « possédaient » la vérité de la Bonne Nouvelle à annoncer, coûte que coûte, de manière prosélyte, quand bien même cela dérange ;
- ceux qui se réfugient dans le silence, tant ils se sentent en porte-à-faux par rapport au discours appelons-le « sacrificiel et doloriste », et habitent leur rôle comme s’ils étaient un visiteur lambda soucieux du bien-être de l’autre mais sans mention aucune de Dieu dont finalement ils ne savent que faire ;
- ceux enfin qui, parce qu’ils ont fait d’une manière ou d’une autre l’expérience de la souffrance, y ont rencontré ce Dieu de Jésus-Christ mis à la question par la radicalité de la souffrance, et ont découvert une profondeur nouvelle, douloureuse mais féconde, dans la lecture de textes bibliques et la prière qui tantôt se fait cri, plainte, silence, révolte, compassion, être-là… Pastorale de l’avoir-mal-à-Dieu (cf. Jean-Baptiste Metz) sans avoir de réponse, promouvant simplement une attitude authentique et vraie de proximité à l’autre comme une forme de pauvreté évangélique.
Attitude difficile et inconfortable que cette dernière posture. Elle invite à assumer le non-savoir autant qu’à respecter l’autre, y compris Dieu, dans leur altérité de proximité, c’est-à-dire dans l’exigence pour celui qui se tient là de se « faire » proche (à l’instar du « bon samaritain ») d’un autrui qui reste bien différent de lui et doit être respecté pour lui-même. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une expérience commune de souffrance ramenant l’autre à un même qui pourra servir de prétexte pour ne pas le reconnaître dans son altérité. Cette attitude est très différente de la seconde posture qui tient du désarroi et essaye bon gré mal gré d’assurer une présence simplement humaine.
Points cruciaux de l’accompagnement chrétien de fin de vie
Pour le croyant qui lutte contre la souffrance, la maladie, la mort, comme pour l’accompagnement, demeurent le combat contre les puissances du chaos et cette question difficile : où est Dieu ? Comment agit-il dans ma vie ? Bien des chrétiens pensent encore qu’il « faut et qu’il suffit » d’unir sa vie finissante au Christ de la Croix pour que l’on soit dans le sensé, dans le serein, et d’une certaine façon, que « tout aille bien ». Ce n’est pas toujours (rarement !) aussi simple. Trois points s’avèrent cruciaux au regard des discours théologiques et des pratiques.
- La souffrance et l’angoisse devant la mort sont celles du péché
Il y aurait donc une forme de « peur chrétienne », ou « religieuse » de la mort en raison du péché qui contribue, dans une perspective juridique, à ériger Dieu en juge.
En fait, que l’on soit chrétien ou non, il y a d’abord la peur de tout être humain face à la mort et ce que celle-ci signifie de rupture, d’inconnu, d’abandon de soi. L’homme qui est le seul dans le règne du vivant à savoir qu’il va mourir, peut mettre sa foi en Dieu, mais cela ne le délivrera pas automatiquement de l’angoisse. Bernanos l’avait bien observé, lui qui au moment d’écrire le Dialogue des Carmélites, souffre d’un cancer et a conscience de sa fin proche. C’est donc aussi sa propre peur qu’il met en scène dans cette pièce. Or, au moment de monter sur l’échafaud, c’est la dernière arrivée au couvent, Blanche de Castille, qui accepte la mort avec le plus de légèreté, comme si elle avait enfilé la mort d’une autre, sa prieure qui, paradoxalement, avait eu tant de difficultés à mourir.
En toutes ces situations, et Jean-Paul II lui-même le rappelait en s’appuyant sur Job, la souffrance et l’angoisse ne signifient pas une situation de péché grave personnel, mais d’abord le poids de la mort, le désir de la fuit, la crainte qui l’entoure et qui est universelle. Dans la Bible, Ben Sirach le rappelle en guise d’avertissement (Si 40, 1-2).
Le croyant peut néanmoins être confronté aussi à une autre dimension d’angoisse ou de souffrance, celle de paraître devant Dieu, voire d’être damné, comme si la proximité de la mort donnait brutalement une consistance nouvelle aux mises en garde de Jésus dans l’Évangile. « Plus que la mort, je crains Dieu », disent certains, ne voyant plus en Dieu que ce juge qui sanctionne et de qui ils risqueraient une peine de mort… Et cette tentation concerne aussi des personnes engagées, ayant réfléchi à leur foi. Mais parce que Dieu reste présent dans la tentation sous le mode de son absence-présence, cela peut les aider personnellement à vivre mieux ce temps. Cela ne signifie cependant pas un privilège en forme de remède répondant à une angoisse chrétienne privilégiée.
- Pour un chrétien, souffrir ne peut être dénué de sens
De nombreux auteurs, aujourd’hui encore, le pensent. Ainsi John Wyatt, professeur d’éthique et de périnatalogie, anglican, écrit dans Matters of Live and Death : « Souffrir ne peut jamais être dénué de sens dans un monde biblique, même si cela a cette apparence. »[14] On peut ne pas percevoir ce sens, mais il demeure et permet de justifier le souffrir, comme le fait l’auteur dans la phrase suivante : « Souffrir est une réalité douloureuse que nous sommes appelés à accepter de la main du Dieu aimant »[15] Il ne fait aucun doute que ce médecin traite la douleur, soigne qui peut l’être, mais il n’en reste pas moins qu’il rejoint aussi ce discours général, à la fois écrit, conférant en quelque sorte un privilège aux chrétiens : celui de posséder un sens pour l’heure de la souffrance et de la mort.
En fait, le sens de la souffrance et de la mort n’est pas une vérité toute faite que l’on possède et à laquelle il suffirait d’adhérer. Chacun peut dans sa vie personnelle donner sens à ce qu’il vit dans une relation étroite à Dieu, nourrie de méditation biblique, de prière, de vie sacramentelle.
Mais la question du sens est autrement plus complexe : elle est pour chacun de l’ordre de l’émergence d’un excès au moment où il fait l’expérience du non-sens. Jésus lui-même, au mont des Oliviers et sur la croix, se heurte à un certain non-sens absolu, il passe par la tentation de la fuite et fait l’expérience du sentiment d’abandon. Il ne faut pas vouloir trop vite, même pour Jésus, projeter du sens sur ce trou noir dont les évangiles ont gardé une trace très claire. Jésus pleinement homme, rejoint l’expérience de tous ceux qui sont eux aussi confrontés à une telle déréliction.
Le chrétien n’est pas au-dessus de son maître, et si toute expérience de mort est singulière, il n’en reste pas moins qu’il est confronté à des degrés divers, comme Jésus, au vertige de la mort, et appelé personnellement, en mobilisant ses ressources intérieures et sa vie relationnelle à Dieu pour donner sens à ce qu’il vit là. Ce sens que je donne personnellement et continuellement à mon existence ne peut être immédiatement transmis à un autre.
- Projeter sa foi sur l’autre, donner sens à son vécu, sans respect de son cheminement
Si la pastorale d’accompagnement des malades est en général respectueuse du désir des patients, il n’en reste pas moins que des tensions subsistent sur le fait de savoir si elle ne devrait pas aussi évangéliser, c’est-à-dire annoncer clairement l’Évangile dans une attitude ouvertement prosélyte. L’intention n’est sans doute pas mauvaise : bien des accompagnants pensent sincèrement qu’ils peuvent du bien en proposant la foi au Dieu de Jésus-Christ ; ils estiment souvent qu’il suffit que le patient connaisse et s’approprie le sens des souffrances de Jésus pour le faire sien, donner sens à sa propre expérience douloureuse et s’en trouver mieux. Ces accompagnants ont l’impression que c’est là leur devoir, que la foi chrétienne est une vérité que l’on doit donner, que c’est obéir au Christ et qu’ils ne sauraient donc se taire. D’ailleurs, ils ont toujours l’un ou l’autre exemple de personnes qui sont revenues à Dieu et se sont montrées reconnaissantes ; ce qui les conforte dans leur attitude.
Néanmoins, une attitude prosélyte volontariste est non seulement inacceptable mais aussi irrespectueuse, voire quelque peu méprisante pour la liberté et la capacité d’autodétermination de l’autre. Le visiteur annoncé comme « aumônier » / « membre de l’aumônerie » peut certes se présenter devant l’autre en se situant, mais ensuite l’autre doit pouvoir consentir à cette visite et au dialogue qui suit. Certes, les situations concrètes sont parfois ou souvent ambiguës : l’état pathologique du patient, ou une révolte qui a besoin de se dire et commence par renvoyer le visiteur… Imposer Dieu ne serait respectueux ni de l’humain libre ni de Dieu même qui propose sans jamais imposer à l’homme de croire. Et vouloir convertir l’autre n’est pas du ressort de l’humain, mais du l’Esprit du Père et du Fils qui précède le visiteur au cœur de tout homme dans lequel « invisiblement, agit la grâce » (Gaudium et Spes 22)[16]. Jésus lui-même n’a pas converti le jeune homme riche. Il n’a jamais profité de la maladie, de la souffrance d’un contemporain pour lui inculquer la foi ou un sens à son souffrir… Il propose une parole en acte qui doit cheminer en l’autre.
Enfin, l’on ne saurait non plus imposer ce sens à la société : je peux évoquer, y compris publiquement, avec des arguments théologiques, la manière dont je lis la Bible, les événements de la passion du Christ ; je peux souligner les relations que je pose avec la souffrance humaine ; je peux rendre compte de mon espérance ; mais le sens ensuite ne peut être donné que par chacun personnellement, à sa propre vie, dans sa confrontation au mal, à la souffrance, à la proximité de la mort. Et je ne peux ni obliger, ni juger, ni même réprouver l’attitude de celles et ceux qui ne pensent pas comme moi… L’accompagnement n’est donc pas attribution de sens, pas même de sens chrétien à la souffrance de l’autre, mais suppose comme disait Jésus de « se faire petit avec les petits » pour les rejoindre tous en touchant son propre fond.
Conclusion : fécondité de l’épreuve ?
On ne pose une telle question qu’avec frayeur et tremblement tant le piège de la justification guette. Et pourtant, on ne peut pas ne pas la poser, car par-delà l’antalgie, l’accompagnement, les soins et bien d’autres choses, on ne sort pas indemne d’avoir été éprouvé jusqu’au tréfonds de son corps. Pourquoi des réconciliations sont-elles possibles en toute fin de vie alors qu’elles ne l’ont pas été une vie durant ? Pourquoi plus généralement confie-t-on tant de choses à certains – ceux que Jésus appelait les « pauvres de cœur » ? – alors que (ou parce qu’)ils sont fragiles et vulnérables ? N’est-ce pas paradoxal ? Telle épouse éprouvée rudement par la progression fulgurante du cancer chez son mari consent après quelques semaines à ce qu’elle pensait inimaginable jusqu’alors : l’hospitalisation à domicile et donc aussi l’idée de la mort à domicile… Deux semaines passent, elle s’est habituée à l’idée, lui aussi, et si les échanges sont très brefs en raison de la fatigabilité du mari, elle lui confie nombre de choses qu’elle ne lui aurait jamais dites autrement. Une délicate et surprenante légèreté traverse le trop lourd quotidien. Grâce…
Ainsi nombre de personnes arrivées en fin de vie deviennent, avant que leur lit ne soit déserté par la peur de la mort, d’extraordinaires confidents et des transmetteurs de l’Essentiel qui tombe de leur bouche et de leur être comme un fruit mûr au terme d’une vie. Leur faiblesse et leur vulnérabilité permettent de mettre en mots ce qu’on n’aurait pu confier autrement, ce qu’on n’aurait pu recevoir autrement… Nouvelle et vraie fécondité. « Baume versé sur tant de plaies », écrit Etty Hillesum[17].
Une telle maturation demande du temps. Mais n’est-il pas temps alors de laisser tomber les voiles de la superficialité au concret de l’altérité d’aujourd’hui dans ses multiples formes, pour un développement conforme à l’esprit de pauvreté évangélique ? N’est-il pas temps de se laisser toucher par l’autre, accepter sa blessure et s’en trouver ressaisi de l’intérieur ? N’est-ce pas ainsi que l’on se prépare à affronter toute épreuve douloureuse et la mort elle-même, en vivant pleinement ?
[1] Jürgen MOLTMANN, Le Dieu crucifié, Paris, Cerf et Maison Marne, 1974, p. 310
[2] J’en réfère à mes propres contributions sur ce sujet. Voir par exemple Marie-Jo THIEL, La santé augmentée : réaliste ou totalitaire ? Montrouge, Bayard, 2014.
[3] On connaît les différents stade (refus-isolement, irritation, marchandage, dépression, acceptation) décrits par Elisabeth KUBBLER-ROSS, Les dernières instants de la vie, Genève, Labor et Fides, 1975. Ces étapes, plus ou moins marquées, ne disent pas tant une succession chronologique imperturbable, que les hauts et les bas qui émaillent toute évolution de maladie sérieuse.
[4] Adolphe GESCHÉ, Dieu pour penser, t. VII, Le sens, Paris, Cerf, 2003, p. 9.
[5] Dorothee SÖLLE, Souffrance, Paris, Cerf (Théologies), 1992, p. 33.
[6] Paris, Seuil, 1969. La première édition date de 1961.
[7] Jean-Baptiste METZ, Memoria passionis. Un souvenir provocant dans une société pluraliste, Paris, Cerf (Cogitatio Fidei 269), 2009, p. 10, note 1.
[8] Et il y aurait aussi à relire les textes du Premier Testament comme l’a fait courageusement le judaïsme au lendemain de la Shoah.
[9] Schématiquement dans cette théologie, il s’agit de « satisfaire » (« réparer ») par l’acceptation de sa souffrance à l’injustice faite à Dieu par l’offense, et avec lui au désordre de la nature créée. Le Christ a souffert et est mort en tant que substitut de l’humanité : il a satisfait par son infini mérite les exigences requises par l’honneur de Dieu, et l’homme doit s’associer à lui, s’unir à sa croix. Des nuances plus ou moins grandes sont apportées après Anselme par Thomas d’Aquin, Calvin, Grotius. Bernard SESBOÜÉ, Jésus-Christ l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, Paris, Desclée (Jésus et Jésus-Christ 33), 1988
[10] François-Xavier DURRWELL, qui était un ami, m’a ainsi redit à maintes reprises la situation de la théologie au moment où il voulait faire sa thèse de doctorat en théologie : « Pourquoi vouloir se pencher sur la Résurrection du Christ, lui disait-on, il n’y a rien à en dire ! C’est la Croix qui est déterminante ». De fait, la résurrection n’était alors qu’un décorum de la Croix… Avec son dernier ouvrage, La Mort du Fils (Paris, Cerf, 2005), auquel son auteur tenait plus que tout, la boucle est bouclée. Jean-Pierre TORRELL rappelle cela quand il écrit : « Si le livre de François-Xavier Durrwell [La Résurrection du Christ, mystère du salut, 1950], aujourd’hui vieilli, connu un succès considérable, cela fut dû en partie à la nouveauté du sujet » (Résurrection de Jésus et résurrection des morts. Foi, histoire et théologie, Paris, Cerf, 2013, p. 108).
[11] Marie-Jo THIEL, op. cit.
[12] Marie-Jo THIEL, « Peut-on espérer un salut des biotechnologies médicales ? » : Passeurs d’espérance. Recherche sur le sens chrétien du salut. Hommage à Charles Wackenheim, Paris, Lethielleux/Desclée de Brouwer, 2011, pp. 269-298.
[13] La question n’est pas que le Magistère doive reconnaitre avortement et euthanasie. La pointe de notre propos est ailleurs : est-ce que le discours théologique mis en œuvre répond aux requêtes de sens de contemporains confrontés à la souffrance et qui ont beaucoup changé au cours des dernières décennies ?
[14] John WYATT, Matters of Live and Death. Human Dilemmas in the Light of the Christian Faith, Foreword by John Stott (1998), Nottingham, IVP, 2009, p. 219. – Cette maison d’édition, acronyme pour InterVarsity Press, publie « des livres chrétiens qui sont fidèles à la Bible et qui communiquent l’Esprit, développent le lien entre disciples, et renforcent l’Église dans sa mission au cœur du monde » (page de garde en introduction, trad. MJT).
[15] Ibid. Italique dans le texte original.Trad. MJT
[16] La Constitution pastorale Gaudium et Spes est consultable à l’adresse http://www.vatican.va/archive/hist_councils/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_fr.html (dernière consultation 5 mai 2015).
[17] Son journal se termine sur ces mots : « On voudrait être un baume versé sur tant de plaies » (Etty HILLESUM, Une vie bouleversée, Paris, Seuil, 1995)
Auteur: THIEL Marie-Jo
« Y a-t-il une théologie de la souffrance face à la fin de vie ? », in Jean-Gustave Hentz et Karsten Lehmühler (éd.), Accompagnement spirituel des personnes en fin de vie. Témoignages et réflexions, Genève, Labor et Fides, coll. « Pratiques », 2015, p. 181-195.